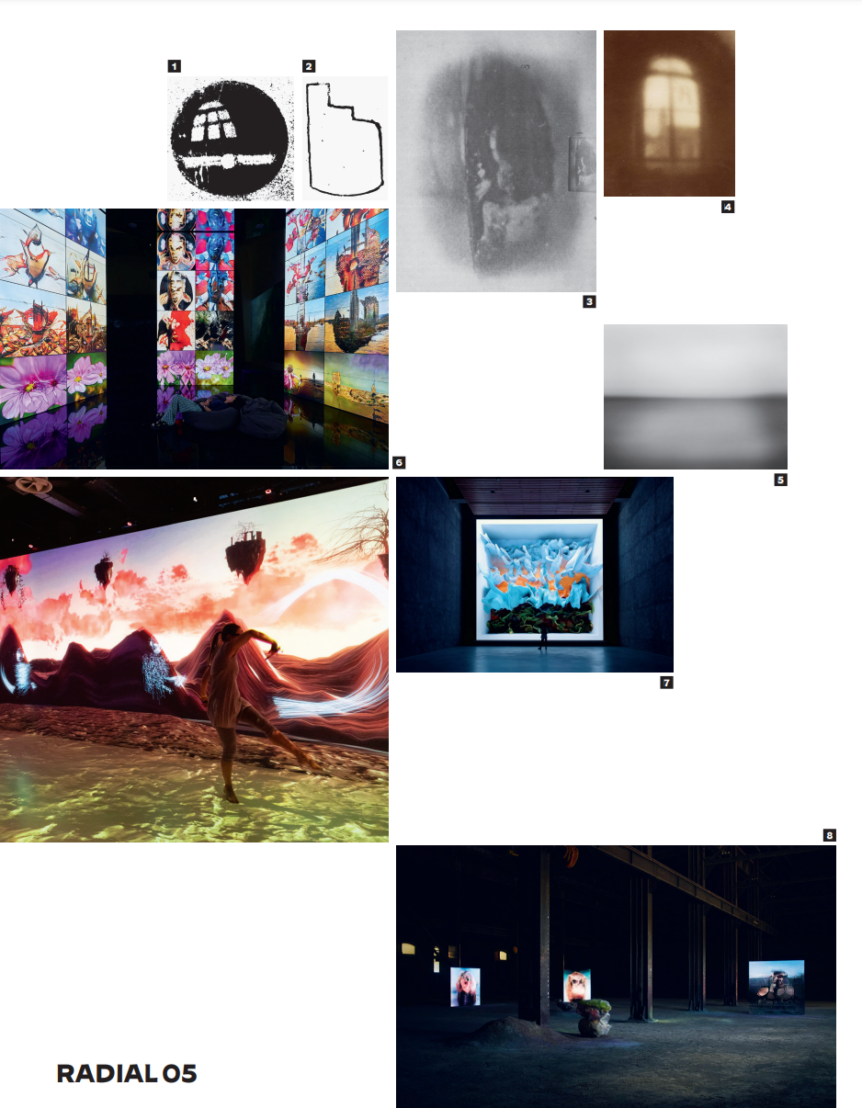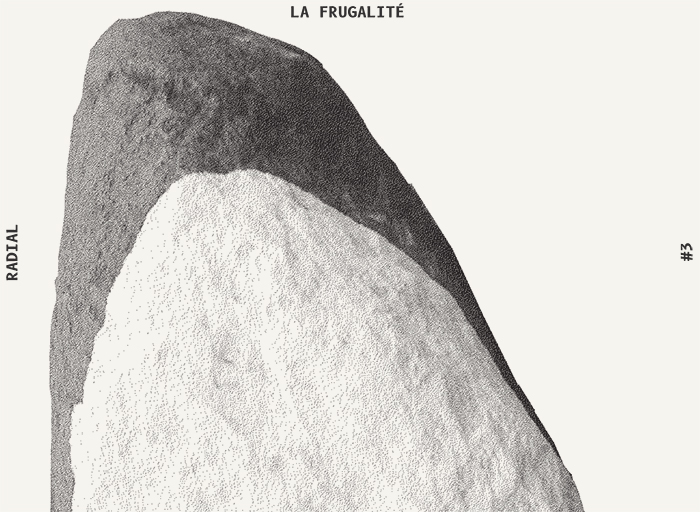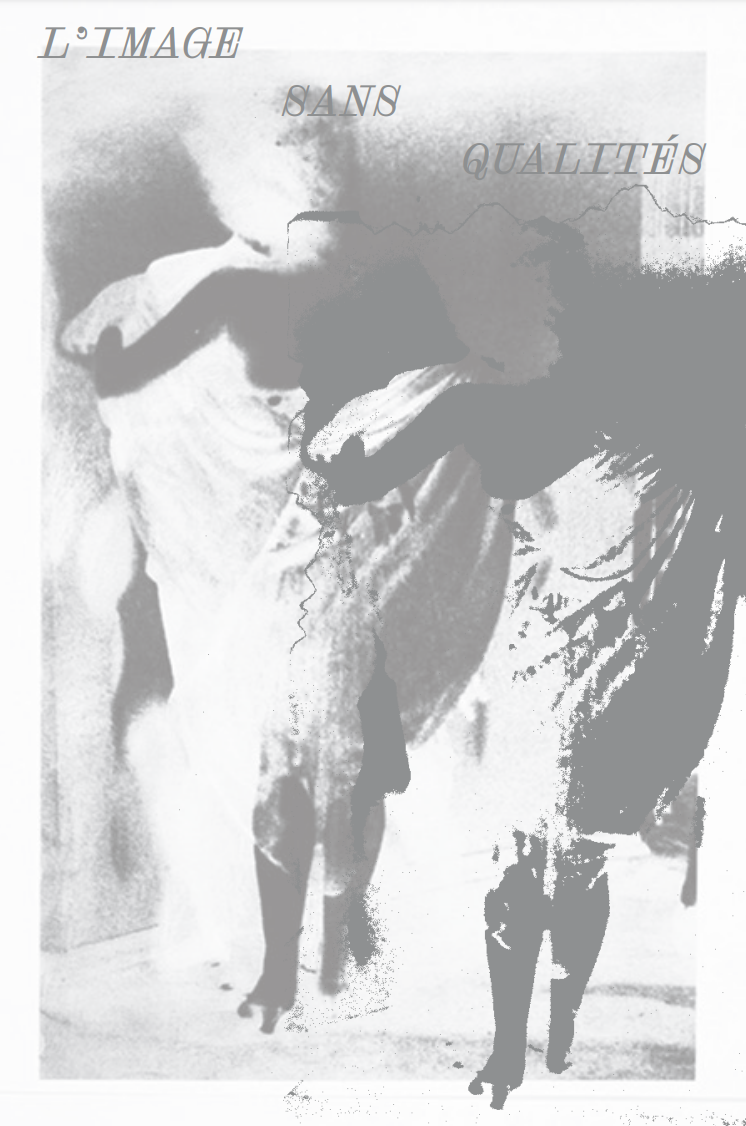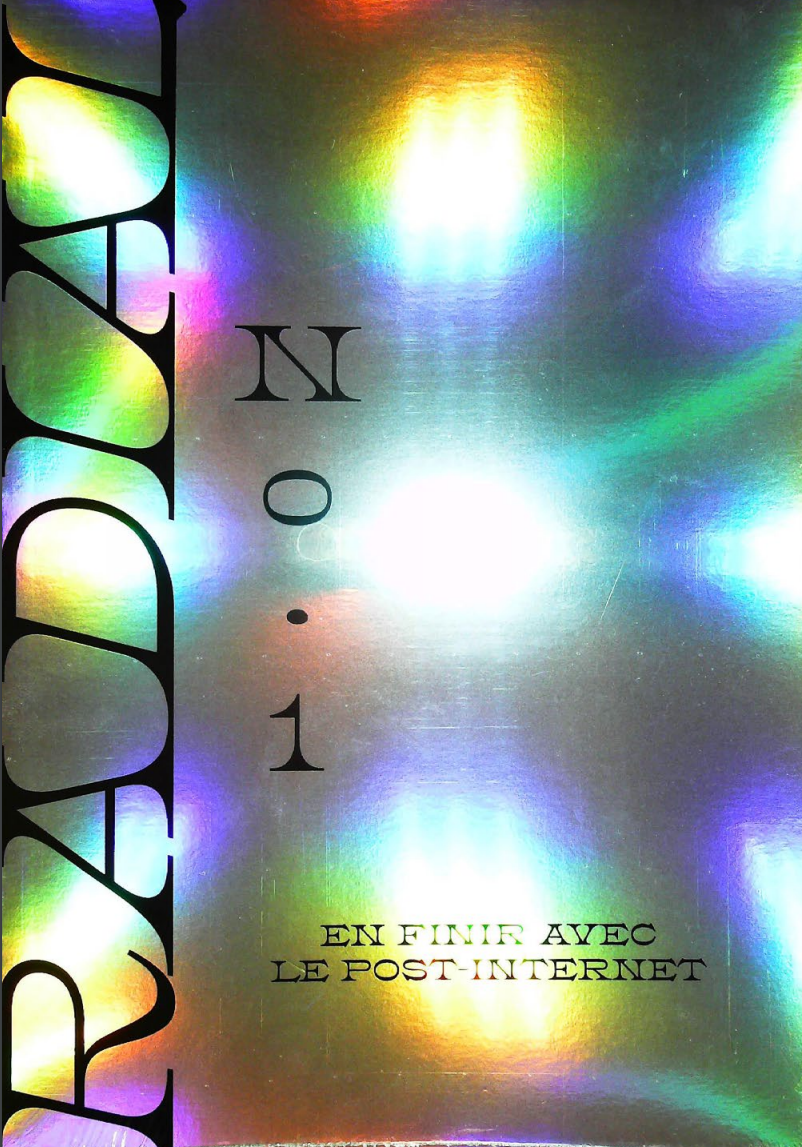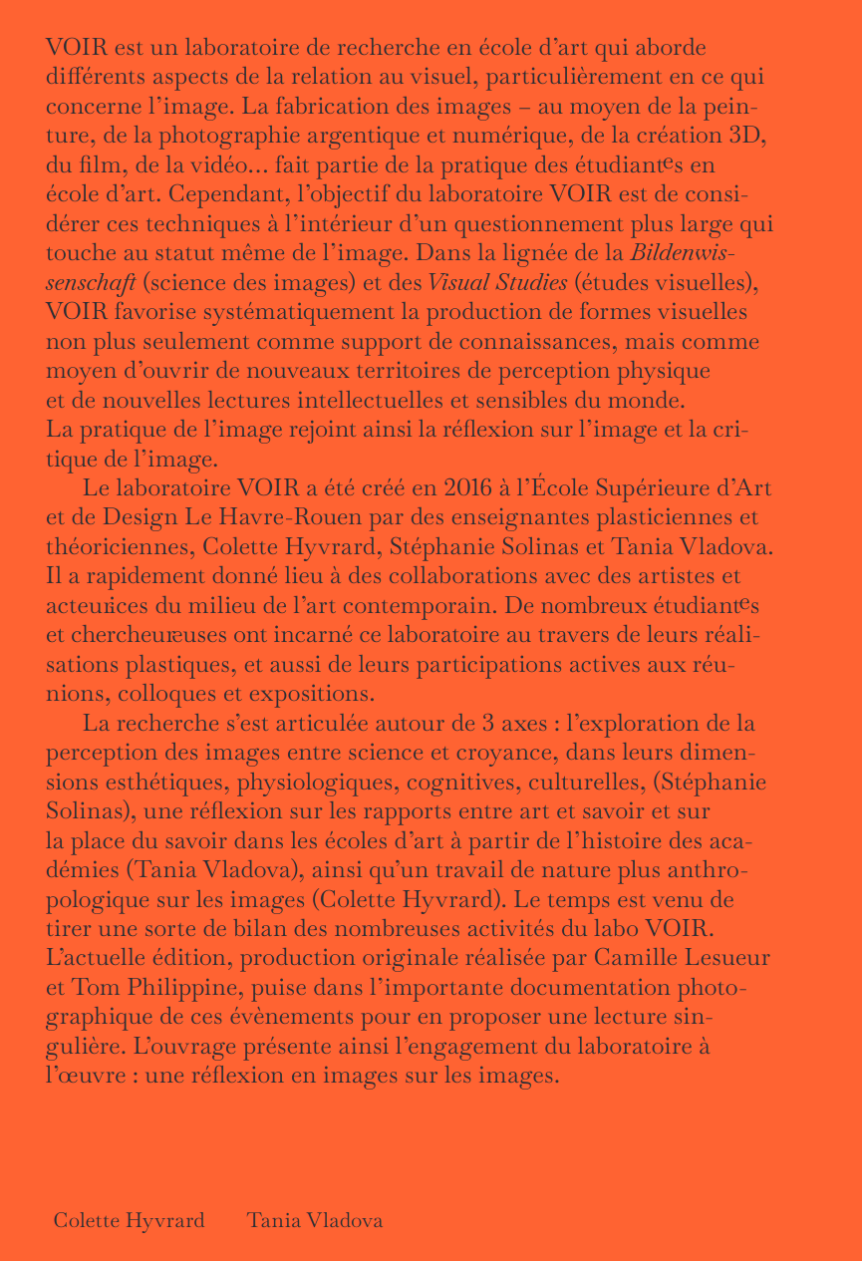Publications
À l’ésadhar, la recherche donne lieu à une divers publications, notamment celles issues des différents groupes de recherche.
La revue thématique annuelle de recherche de l’école, anciennement RADIAL (2018–2023), se réinvente en 2025 pour devenir ard – Art Recherche Design. Cette nouvelle version propose des articles scientifiques ainsi que des formats de publications expérimentaux.
Revue ↓
Fiction science
| #00
La revue Fiction-Science se propose de mettre en évidence et d’explorer différentes strates de ces liens. Elle se veut un terrain de rencontre entre artistes et scientifiques où coexistent la liberté de la rêverie, l’audace de l’humour et le sérieux de la recherche en art et en science. Elle accueille des travaux/ idées aboutis, mais aussi des expérimentations de bricolage science-art en cours ou à venir, réalisées ou juste pensées.
Ce numéro regroupe des contributions d’artistes et chercheurs ayant oeuvré dans le Vimeu, territoire picard situé aux portes de la Normandie, bastion ancestral de la serrurerie.
Fiction-science est une revue de recherche et bricolage science-art. Fondée en 2021 par Dominique De Beir (ésadhar), Samuel Etienne (EPHE-PSL) et Tania Vladova (ésadhar). Conception graphique de Samuel Etienne et Stéphanie Guglielmetti. Édition par Strandflat et distribution par Les presses du réel.
| 2023 | |
Radial n°5
| La photographie à l’épreuve de l’abstraction
Pour sa nouvelle édition, la revue Radial a souhaité se pencher sur la présence, résurgence ou persistance de l’abstraction dans la photographie actuelle. Ce numéro fait suite à l’exposition conçue en 2021 par le Frac Normandie Rouen, en collaboration avec le Centre photographique d’Île-de-France, à Pontault-Combault, et le centre d’art Micro Onde à Vélizy1, ainsi qu’à la journée d’étude qui l’avait accompagnée en novembre à l’initiative du Frac et de l’ésadhar – École supérieure d’art et de design Le Havre-Rouen. Intitulée La Photographie à l’épreuve de l’abstraction, l’exposition, organisée simultanément par les trois institutions sur chacun des lieux, avait pour dessein de mettre en lumière les diverses manières dont les artistes, en ce tournant du XXIe siècle, continuent à recourir à des formes abstraites ou non figuratives dans leurs travaux photographiques.
Sous la direction de Véronique Souben avec la participation de Michelle Debat, Vincent Bonnet, Marc Lenot, Héloïse Conésa, Julie Martin, Nathalie Delbard, Audrey Illouz, Simon Zara, Julien Lomet, Carla Gannis, Calypso Legendre, Lise Sagnes et Maxence Alcalde.
| 2023 | |
Radial n°4
| Les arts de l’architecture
Pour le numéro 4 de la revue Radial, l’ésadhar a invité l’ENSA Normandie à prendre la direction de sa rédaction. Cette invitation par une école d’art auprès d’une école d’architecture est d’autant moins anodine qu’elle va à l’encontre de la séparation instituée entre l’enseignement des arts plastiques et celui de l’architecture depuis la fin des années 1960. À cette époque, pour l’architecture, il s’agissait de prendre son autonomie en réunissant dans une même formation les disciplines la concernant directement, tout en se rapprochant de l’Université et des méthodologies scientifiques d’analyse. Avec le temps, cette orientation a eu pour conséquence d’obscurcir le rapport entre art et architecture. D’un côté, dans les écoles d’architecture, il est devenu difficile de parler d’architecture en tant qu’art et création ; et, a contrario, les installations, happenings et toutes formes d’intervention artistique dans l’espace public sont quasiment assimilés à de la pratique architecturale. Pour honorer l’invitation dans cette revue d’art, l’école d’architecture a trouvé opportun de repenser l’architecture en tant qu’art ; à commencer par l’art propre à l’architecture, l’art de bâtir comme source d’une poétique se déployant dans le réel, et aussi en considérant les arts intervenant dans le processus de création architecturale.
Sous la direction d’Arnaud François et avec la participation de Hedia Ben Nila, Haïfa Miled, Mounir Dhouib, Jeremy Hawkins, Alicia Chauvat, Arnaud François, Michel Matival, Brigitte Poitrenaud-Lamesi, Rémi Groussin, Apolline Brechotteau, Blanche Bertrand, Clément Hébert et Misia Forlen.
| 2022 | |
Radial n°3
| La frugalité
Lorsqu’à la fin 2019, le comité de rédaction de Radial s’est réuni afin d’élaborer une thématique pour son troisième numéro, nous ne pouvions nous douter que, quelques mois plus tard, l’actualité de la notion de frugalité allait prendre une tournure toute particulière. Avec l’apparition de la Covid-19 et sa rapide propagation entraînant le confinement des populations, les interrogations sur l’usage du monde ont semblé s’imposer de manière concrète. Pendant cette période, on a pu réfléchir à nos besoins et aux impasses d’un modèle qui nous occupe probablement trop souvent à des tâches non essentielles. C’est dans ce contexte que l’idée de « frugalité » s’offre à l’actualité.
Sous la direction de Maxence Alcalde et avec la participation de Brigitte Poitrenaud-Lamesi, Laurent Tixador, Julie Beauté, Dominique Gauzin Muller, Alexandre Melay, Jean-Batiste Farkas, Katja Gentric, Arnaud François et Matthieu Martin.
| 2020 | |
Radial n°2
| L’image sans qualités
Le présent volume contient deux dossiers distincts, comportant des articles dont le point commun est la réflexion sur le statut, la production et le fonctionnement de l’image aujourd’hui. Le premier dossier, qui a donné son titre à l’ensemble, est issu d’une sélection de contributions au colloque international L’image sans qualités (Rouen, 2018) et d’articles sollicités et sélectionnés dans un second temps. Il réunit des textes d’artistes, commissaires d’exposition, historiens, anthropologues et philosophes proposant une réflexion sur la production et l’usage croissant d’images banales, ordinaires, voire ennuyeuses, des images qui défient ou subvertissent la représentation ou encore dont les caractéristiques matérielles infimes les rendent à peine perceptibles.
Le second dossier, intitulé Varia, comprend quant à lui des contributions proposées par des artistes et des chercheurs pour la plupart issus des établissements partenaires du Doctorat RADIAN, à savoir l’École Supérieure d’Art et Design Le Havre/Rouen, l’école supérieure d’arts et médias de Caen, l’École nationale supérieure d’architecture de Rouen et l’École doctorale 558, Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage.
Sous la direction de Tania Vladova et Colette Hyvrard et avec la participation de Nora Labo, Maddalena Parise, Jacques Leenhardt, DianeWatteau, Emmanuel Zwenger, Berenice Serra, Jean-Noel Lafargue, Pravdoliub Ivanov, EDITH, ArnaudFrançoi, Laurent Buffet, Michal Kozlowski, Jean-Louis Vincendeau, Bachir Soussi Chiadmi et Stephan Köhler.
| 2019 | |
Radial n°1
| En finir avec le post-internet
Rares sont les moments aussi riches que celui du lancement d’une nouvelle revue de recherche. Radial prend racine dans un contexte particulièrement excitant, celui des débats sur la recherche dans les écoles supérieures d’art (arts plastiques, design graphique, architecture et création littéraire) et des nouveaux enjeux qui découlent de partenariats inédits avec l’Université. Cela fait déjà quelques années que les écoles supérieures d’art s’interrogent sur l’opportunité de la création de doctorats, ainsi que sur la manière dont il serait possible de défendre la spécificité d’une recherche en art à l’intérieur de formes institutionnelles déjà très balisées.
C’est donc dans cet environnement que nous avons créé la revue Radial, la revue de recherche de l’Unité de recherche RADIAN (Recherche, Art, Design, Innovation, Architecture en Normandie), initiative conjointe de l’École supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg (ESAM), l’École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen (ESADHaR), l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie (ENSA) et L’école doctorale 558 « Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage» (l’ED 558).
Sous la direction de Maxence Alcalde et avec la participation de Grégory Chatonsky, Garam Choi, Jacques Perconte, Laura Partin, Émilie Brout et Maxime Marion, Stéphane Trois Carrés, Guillaume Sorensen, Yann Owens et Dominique Dehais.
| 2018 |
Edition ↓
Edition de recherches curatoriales
| Recettes de Grand’Mare
Les recettes qui composent cet ouvrage témoignent de la richesse gastronomique, culturelle et associative du quartier de la Grand’Mare. Elles ont été recueillies entre décembre 2023 et mai 2024 par Alice Feuillère, Emma Maignan et Shenxi Song, trois étudiantes de l’ésadhar — l’école supérieure d’art et de design Le Havre Rouen, dont le campus rouennais est installé à la Grand’Mare depuis 2014 — et Virginie Bobin, qui a initié ce projet à l’occasion d’une résidence curatoriale de neuf mois à l’école d’art. À travers la diffusion d’un questionnaire, la participation à des ateliers et l’organisation de rencontres, cette collecte de recettes a servi de point de départ à de nombreux échanges autour de l’alimentation dans le quartier et de son histoire, ainsi que des parcours, mémoires et aspirations des personnes qui l’habitent, y étudient, y travaillent et s’y impliquent.
Dans les recettes et les récits qui les accompagnent, on entend l’écho des souvenirs de famille, des vies ouvrières, des trajectoires d’exil, de la débrouille étudiante, des préoccupations économiques ou écologiques, du souci de l’autre, du plaisir de transmettre et de goûter ensemble. Parfois reproduites telles qu’on nous les a confiées, parfois donnant lieu à des créations littéraires ou vidéos, ces recettes dressent un portrait choral, éclectique et appétissant de la Grand’Mare et des personnes généreuses et engagées que nous y avons rencontrées.
Conception et coordination éditoriale Virginie Bobin, conception graphique et maquette Solène Langlais. Collecte des recettes et rédaction Virginie Bobin, Alice Feuillère, Emma Maignan et Shenxi Song.
| 2024 | |
Voir
| Archives photographiques des activités du Labo VOIR
Cet objet éditorial a été réalisé à partir d’archives photographiques, présentant les activités du Labo VOIR tout au long de son existence. La richesse visuelle de ce fonds d’images a permis la réalisation d’une œuvre iconographique monumentale de 4 mètres sur 3 sur l’un des murs de la Galerie 65 à l’ésadhar-Le Havre.
Inspiré·es par l’historien de l’art Aby Warburg et l’écrivain André Malraux, nous avons associé et confronté sans hiérarchie des reproductions d’œuvres, des clichés d’actualité, des sculptures, des visuels graphiques ainsi que des captures d’écrans sur une immense surface murale, dans le but de comprendre tangiblement, par une vue d’ensemble, les témoignages de chaque image et ainsi d’en produire de nouvelles lectures. Hors de toute logique chronologique, nous avons réalisé des juxtapositions iconographiques selon des rapports lexicaux, colorimétriques ou formels, avec subjectivité. Une fois le mur d’images encollé et achevé, il a été présenté au public lors du vernissage de l’exposition Extension en avril 2022 à la Galerie 65, proposant aux spectateur·ices de laisser flâner leur regard à travers cette constellation d’images et de créer leur propre récit en explorant les corrélations établies. La finalité de ce projet a été la captation du mur au moyen d’un scanner portable afin de transférer l’œuvre murale au sein du présent objet éditorial et d’archiver le travail plastique et temporaire réalisé. La trame, quant à elle, constitue un témoignage du passage de l’aspect brut du mur à l’impression.
Les différents passages tangibles des images liés aux différentes étapes de la reproduction technique ont fortement altéré leur qualité, questionnant ainsi leur condition et leur manière d’être perçues par les lecteur·ices. Le morcellement par le passage du scan invite de ce fait à explorer par une approche active et vagabonde ces fragments d’images comme autant d’indices d’un ensemble. Le cahier central présente, au moyen d’images photographiques documentaires, l’accrochage des expositions du laboratoire confronté à celles réalisées lors de la réalisation du mur d’images dans une sorte de mise en abîme.
Cette édition est pensée comme une réalisation à part entière du labo VOIR qui contribue à repenser art et design graphique dans un objectif commun. Sous la direction de Colette Hyvrard, Tania Vladova et Gilles Acézat et la réalisation Camille Lesueur et Tom Philippine.
| 2022 |